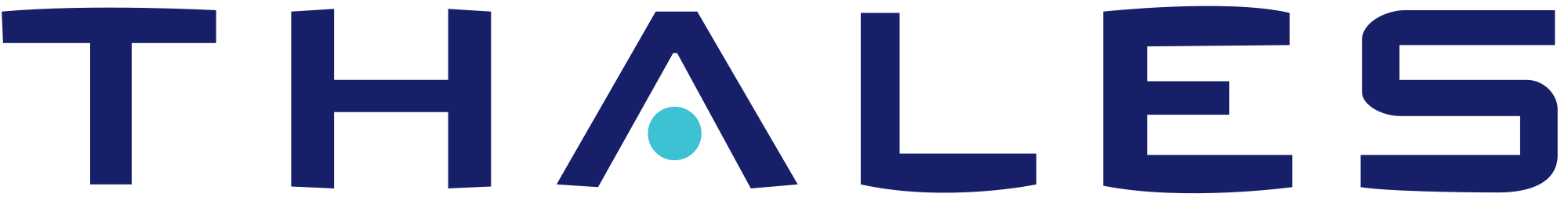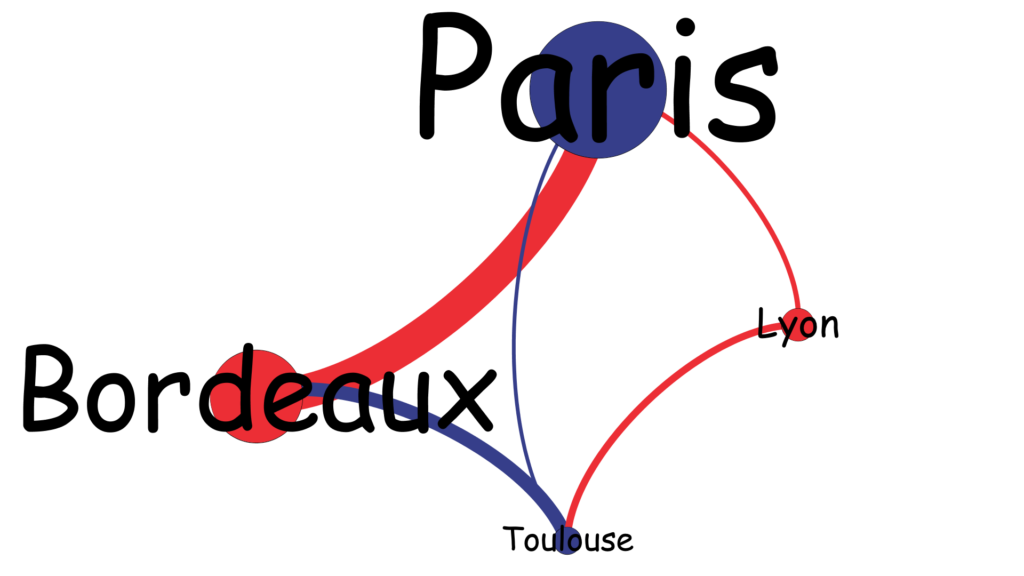#3 – LES RÉGIMES AUTORITAIRES SONT-ILS PLUS EFFICACES ?
D’après Alice EKMAN, spécialiste de la Chine et l’Asie, tout n’est pas que politique, et dépend d’une diversité de facteurs : le système de santé du pays, la proximité par rapport à l’épicentre, les expériences passées, les habitudes de la population … En Chine, le système politique est assez paradoxal. Il y a à la fois un parti unique (représenté à l’hôpital) et en même temps, un système de santé efficace, moderne, avec des médecins ayant étudié à l’étranger, très professionnels. La construction d’un hôpital en 10 jours est certes un tour de force, qui sert aussi la glorification du modèle de gouvernance chinois. Mais au début, la Chine a caché l’épidémie, et contraint le Dr « lanceur d’alerte » Li Wenliang à s’excuser pour ensuite le glorifier tel un héros national ! Enfin, il y a, aussi en Chine, une tradition de contournement des règles, y compris dans un système fortement centralisé avec beaucoup de restrictions … Par ailleurs, on voit que des démocraties ont très bien réussi à gérer la crise, le Japon, Taïwan, la Corée du Sud. Pourquoi pas la France …
En savoir plus